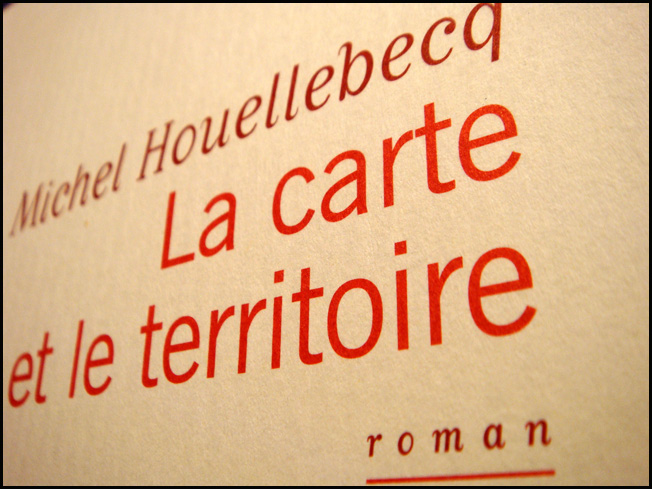
Michel Houellebecq se met en scène dans
son roman. Il reçoit la visite d’un peintre célèbre, Jed Martin. L’écrivain et
le peintre dialoguent entre deux verres de vin.
Houellebecq hocha la tête, écartant les bras comme
s’il entrait dans une transe tantrique1 – il était, plus
probablement, ivre, et tentait d’assurer son équilibre sur le tabouret de
cuisine où il s’était accroupi. Lorsqu’il reprit la parole, sa voix était
douce, profonde, emplie d’une émotion naïve. « Dans ma vie de consommateur,
dit-il, j’aurai connu trois produits parfaits : les chaussures Paraboot Marche,
le combiné ordinateur portable – imprimante Canon Libris, la parka Camel
Legend. Ces produits je les ai aimés, passionnément, j’aurais passé ma vie en
leur présence, rachetant régulièrement à mesure de l’usure naturelle, des
produits identiques. Une relation parfaite et fidèle s’était établie, faisant
de moi un consommateur heureux. Je n’étais pas absolument heureux, à tous
points de vue, dans la vie, mais au moins j’avais cela : je pouvais, à
intervalles réguliers, racheter une paire de mes chaussures préférées. C’est
peu mais c’est beaucoup, surtout quand on a une vie intime assez pauvre. Eh
bien cette joie, cette joie simple, ne m’a pas été laissée. Mes produits
favoris, au bout de quelques années, ont disparu des rayonnages, leur
fabrication a purement et simplement été stoppée – et dans le cas de ma pauvre
parka Camel Legend, sans doute la plus belle parka jamais fabriquée, elle n’aura
vécu qu’une seule saison… ». Il se mit à pleurer, lentement, à grosses gouttes,
se resservit un verre de vin. « C’est brutal, vous savez, c’est terriblement
brutal. Alors que les espèces animales les plus insignifiantes mettent des
milliers, parfois des millions d’années à disparaître, les produits
manufacturés sont rayés de la surface du globe en quelques jours, il ne leur
est jamais accordé de seconde chance, ils ne peuvent que subir, impuissants, le
diktat2irresponsable et fasciste des responsables des lignes de
produit qui savent naturellement mieux que tout autre ce que veut le
consommateur, qui prétendent capter une attente de nouveauté chez
le consommateur, qui ne font en réalité que transformer sa vie en une quête
épuisante et désespérée, une errance sans fin entre des linéaires3 éternellement
modifiés ».
1)État
second qui se traduit par une altération de la conscience et une agitation du
corps. 2)Chose imposée. 3)Rayons d’un magasin.
COMPRÉHENSION
1)Quelle image de
Houellebecq donne le narrateur ?
Houellebecq
est ici peint comme le prototype de l’homme de la société de consommation :
abruti par la vie moderne, il n’arrive pas à être heureux, surtout du point de
vue sentimental («quand on a une vie intime en ces pauvres », l.10), et il
cherche un appui dans l’achat de produits qui lui donne l’illusion du bonheur. Il
est tellement intégré dans le système d’identification sociale entre homme et
produit, qu’il ne comprends même pas pourquoi «alors que les espèces animales
les plus insignifiantes mettent de milliers, parfois des millions d’années à
disparaître, les produits manufacturés sont rayés de la surface du globe en
quelques jours » (l.15-17), comme si les objets mêmes faisait partie du
processus d’évolution.
2)Quelle est la tonalité
de cette évocation de l’écrivain ?
Houellebecq
est dans un état d’altération dû à l’alcool. Donc, ça réflexion vient plus de
son inconscient que d’un vrai raisonnement. Voilà pourquoi le ton de son
invocation et souvent confus, exagéré et haussé, avec des moments de
désespérance ( «cette joie simple ne m’a pas été laissée», l.11 ; «
c’est terriblement brutal », l.15), opposés à des moments de fureur, où il
accuse le mécanisme de la consommation d’être injuste, un « diktat irresponsable
et fasciste » (l.18).
Il
se sent, donc, d’une certaine façon victime de ce système et il l'exprime
sincèrement.
INTERPRÉTATION
1)Les images commerciales
sont très présentes dans cet extrait ; pourquoi selon vous ?
L’auteur
veut souligner le complet asservissement d'Houellebecq aux produits qu’il aime
le plus, dans lesquels n'importe quel lecteur moderne peut s’identifier. Il
veut, donc, récréer l’aliénation que la publicité provoque en nous qui vivons
dans une société de consommation, à travers le même principe de la publicité, c’est-à-dire
la répétition obsessionnelle du nom du produit et des « bénéfices
sociaux » qu’il nous apporte. On pourrait, donc, conclure qu’il se sert d’un
langage post-moderne, fait de symboles, c’est-à-dire celui de la publicité,
pour critiquer indirectement le mécanisme économique.
2)Quels liens unissent
les hommes aux objets selon Houellebecq ?
Selon
Houellebecq les hommes sont liés sentimentalement aux objets («ces produits,
j’ai les ai aimés, passionnément », l.7), c’est-à-dire qu’il humanise et
personnifie les produits, afin de trouver en eux l’amour qu’il n’a pas dans sa
vie.
Les
objets deviennent, donc, la seule garantie d’amour de l’homme moderne qui, à
partir du XX e siècle et des
théories nihiliste de Nietzsche, découvre qu’il est être seul dans l’univers et
que Dieu n’existe pas.
3)De quoi le personnage
Houellebecq a-t-il nostalgie ?
Le
personnage a nostalgie de l’amour qu’il croyait recevoir de ses produits
favoris, puisque leur fabrication a été stoppé. Il exprime sa douleur de façon
si franche, que le lecteur y croit vraiment, comme s’il parlait d'un ami ou
d’un parent perdu. Enfin, il décrit toute l’injustice de cet éloignement, qui
lui provoque une souffrance immense.
RÉFLEXION PERSONNELLE
Un peu plus loin dans ce
même roman, Michel Houellebecq écrit « Nous aussi nous sommes des
produit »
Développez
ce thème en vous appuyant aussi sur d’autres œuvres que vous avez
lues. (600 mots environ).
Il
y a une liaison profonde entre désir et représentation publicitaire qui se base
sur le fait que l’homme cherche toujours à réaliser des désirs qu’il ne peut pas
rejoindre (on pourrait dire, donc, qu’il désire son désir même, plutôt que
l’objet en soi). La perversion et en même temps toute la magie de la publicité
est de fournir aux consommateurs l’illusion d’être tout à fait exceptionnels et
de s'identifier avec un groupe social précis. Toutefois, ce mécanisme parfait
ne fonctionne pas sans les consommateurs, la « matière première » de
ces processus. Aujourd’hui on les voit bien dans le phénomène de la vente des
données personnelles pour la propagande électorale, qui personnalise la
publicité selon les désirs et les intérêts de chacun. Nous sommes, donc, un
produit dans le sens que la société de consommation adapte la production d'objets
à nos désirs.
Donc,
aujourd’hui l’homme a une valeur qui n’est plus seulement lié à ses capacités
de fabrication d’un objet, comme dans la société industrielle du XIXe siècle,
mais il est aussi le produit même du processus économique.
L’une
des causes les plus importantes de ce phénomène est la globalisation, le fait
qu’aujourd’hui les modes se diffusent très rapidement, en imposant des styles
de vie globaux.
Mais,
alors, c’est nous-même qui décidons de nous adapter à ces modèles ou ce sont
les modèles qui changent selon nos désirs ?
On
pourrait dire que les deux s’influencent réciproquement, comme les pièces d’une
parfaite machine.
Morgana Capasso
COMPREHENSION
1) Quelle
image d’ Houellebecq donne ici le narrateur?
Houellebecq est présenté par le narrateur comme un homme tristement résigné
et irrémédiablement déçu. Il montre tout son amer désappointement à travers des
gestes exagérés et presque théâtraux (« Houellebecq
hocha la tète, écartant les bras comme s’il entrait dans un transe tantrique »
l.1) qui sont, peut-être, justifiés par son ivresse (« il était plus probablement ivre l.2 »). Cependant, sa
voix « douce, profonde, emplie
d’une émotion naïve » (l.3) trahit son tragique désespoir,
explicitement révélé par ses mots et par ses larmes (« il se mit à pleurer lentement et à gros gouttes » l.14).
La description des actions à la troisième personne et le discours direct
permettent au narrateur de peindre un portrait complet et détaillé du
personnage, en décrivant minutieusement son état d’âme, dans un climax
croissant : de la désillusion à la tristesse des pleurs jusqu’à la rage
des accusations finales.
2) Quelle est la tonalité de cette évocation de
l’écrivain ?
Cette évocation de l’écrivain est caractérisée par une tonalité
tragiquement pathétique, qui marque, surtout, le discours de l’Houellebecq.
L’utilisation d’adjectifs apparemment exagérés, qui souvent personnifient même
les objets (« …ma pauvre parka Camel
Legend, sans doute la plus belle parka jamais fabriquée, elle n’aura vécu
qu’une seule saison… » l.12) contribue à exaspérer la narration, et
parfois, à créer aussi de l’ironie. En outre la répétition des mots (« cette joie, cette joie simple »)
et l’ antithèse (« c’est peu, mais c’est beaucoup.. ».)
donnent au texte un effet rhétorique et emphatique, repris par l’auteur dans son
deuxième discours, dans lequel le
personnage présente les produits manufacturés comme des victimes, impuissants
et faibles, d’une société cruelle et « inhumaine ».
INTERPRETATION
1) Les
images commerciales sont très présentes dans cet extrait : pourquoi selon
vous ?
Cet extrait est caractérisé par un répétition, presque obsessive, de mots qui font référence
au commerce et aux images commerciales. Cette insistance souligne l’importance
fondamentale des produits manufacturés dans la vie du personnage mais permet
aussi à l’écrivain de dénoncer implicitement l’absurdité de la société
consommatrice. Dans la dernière partie de l’extrait, en effet, l’auteur
critique âprement les lignes de produit qui contrôlent même les vies des
consommateurs, qui sont égarés dans une « errance sans fin entre des linéaires éternellement modifiés » (l.21-22).
Les images commerciales dans l’extrait évoquent aussi la quantité exagérée et
presque excessive de produits, qui, souvent, diffèrent seulement par leurs
noms, mais pas par leur qualité.
2) Quels
liens unissent les hommes aux objets selon Houellebecq ?
En montrant « sa vie de consommateur »,
Houellebecq se concentre surtout sur la description de son rapport avec trois
produits qu’il considère « parfaits »,
ses produits favoris. Dans cette longue description il utilise des mots et des
expressions qui appartiennent au champ lexical sentimental et amoureux :
il affirme qu’il aimait « passionnément »
les trois produits, avec lesquels il aurait passé toute sa vie. La relation qui
le liait à ces objets était « parfaite
et fidèle », car il les rachetait régulièrement et eux seuls étaient
capables de le rendre heureux. Selon Houellebecq, donc, les hommes sont
indissolublement unis aux objets par des liens indispensables et essentiels,
fondés sur une fidélité réciproque, qui est l’unique raison de bonheur.
3) De
quoi le personnage Houellebecq a-t-il nostalgie ?
Le personnage Houellebecq a surtout nostalgie de ses objets favoris ( « les chaussures Paraboot Marche, le combiné
ordinateur-imprimante Canon Libris, la Parka Camel Legend » l.4-5 ). Ces objets, en effet, « ont disparu des rayonnages » après que « leur fabrication a.. été stoppée ». La
condition de mélancolie du personnage est soulignée principalement par
l’opposition entre passé et présent, mise en évidence par le changement du
temps verbal : il utilise l’imparfait
pour décrire « sa relation
parfaite avec les produits » ,
le passé composé pour désigner le sort « tragique » des
produits et, enfin, le présent pour présenter la triste réalité des produits
manufacturés. En outre, la nostalgie d’Houellebecq est parfaitement et
dramatiquement communiquée par la sentence résignée « Eh bien, cette joie, cette joie simple, ne m’a pas été laissée.. »(l.10-11).
Cependant, le fait que Houellebecq ne croit pas être complètement heureux ( « Je n’était pas absolument heureux à
tous points de vue, dans la vie »
l. 8; «Surtout quand on a une vie intime assez pauvre » l.10)
suggère aussi qu’il a nostalgie d’une vie plus heureuse et satisfaisante.
REFLEXION PERSONNELLE
Un peu plus loin de ce même roman, M. Houellebecq écrit «
Nous aussi nous sommes des produits ». Développez ce thème en vous appuyant
aussi sur d’autres œuvres que vous avez
lues.
La sentence de Michel Houellebecq dénonce et condamne une situation sociale
très actuelle, de plus en plus
menaçante . En disant que nous aussi nous sommes des produits,
l’auteur veut souligner que la distance entre « homme » et
« produit » devient de plus en
plus faible, surtout dans une société consommatrice et frénétique, où
l’individualité est généralement suffoquée par le désir (et aussi l’exigence)
de se conformer.
L’importance des objets dans la vie humaine joue un rôle fondamental et
essentiel dans le roman « Madame Bovary » de Gustave Flaubert. La
protagoniste du roman , Emma Bovary, réprime sa condition d’insatisfaction et
mécontentement par une tendance, obsessive et exagérée, à acheter des produits
inutiles, qui pourraient compenser sa situation tragique. Cependant, cette
exigence d’acheter n’est qu’une illusion éphémère qui la mène aussi au suicide,
car elle ne réussit pas à accepter et avouer ses énormes dettes.
Cette conception de l’inutilité des objets est fondamentale dans les œuvres
artistiques de Andy Warhol, un artiste américain qui a utilisé des produits de
marchandise pour souligner l’inutilité de la production massive. La phrase d’ Houellebecq évoque surtout les
portraits que Warhol a réalisé en représentant, par exemple, Marilyn Monroe. Le
visage de la femme est reproduit plusieurs fois à fin d’évoquer la production
et la fabrication des produits, qui a eu lieu surtout après la Révolution Industrielle.
L’actrice, dans les portraits perd son individualité et dévient un
« objet » que tout le monde peut posséder et acheter.
La sentence de l’écrivain est très significative, car met aussi en évidence
que lorsqu’on est tous des produits, on est tous égaux et impersonnels.
Michele Cova





